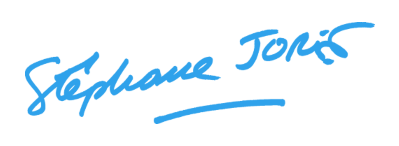Si l'on ne comprend pas ce que le jury attend, on a toutes les chances d'échouer.
Pour éviter cela, on peut passer en revue le répertoire des compétences attendues. Cette grille indicative est fournie sur le site web de l'Education Nationale et dans le livret "Comment devenir Ingénieur Diplômé Par l'Etat" distribué à tous les candidats lors de l'inscription. Il est ensuite aisé de puiser, dans son expérience professionnelle et dans le projet qui fait l'objet du mémoire, pour mettre en lumière chaque compétence attendue.
Ce travail vise à bâtir un plan de mémoire valable et à ne pas commettre d'erreurs sur la rédaction du contenu.
Il est possible d'étudier les mémoires conservés à la bibliothèque du CNAM. Pour gagner du temps sur place, il vaut mieux venir avec sa liste préétablie de documents. Il est facile de la dresser car l'inventaire des ouvrages est disponible sur le site web du CNAM. Pour les trouver, utiliser le mot-clef "dpe" dans le moteur de recherche. Les mémoires ne peuvent être consultés que sur place. Ils ne peuvent être emportés en aucun cas. On peut apporter avec soi un ordinateur portable et un scanner ou bien un appareil photo numérique pour numériser les portions de documents les plus intéressantes (sommaire en particulier). Ceci permet de comparer à posteriori son plan avec celui de mémoires validés. Ceci est particulièrement constructif lorsque, à force de travailler son plan, on fini par manquer totalement de recul et de clairvoyance.
Il est également possible de demander à un ingénieur DPE de transmettre son mémoire afin de voir comment il a procédé. Pour cela, il suffit contacter la Société des Ingénieurs Diplômés par l'Etat (SIDPE) afin d'être mis en relation avec quelqu'un.
Enfin, la solution la plus simple consiste à télécharger sur ce site web des mémoires d'ingénieur disponibles dans différentes disciplines. Au besoin, je peux vous mettre en relation avec leurs auteurs si vous me le demandez via le formulaire de contact.
Tout commence par cette étape : trouver un bon sujet pour son mémoire. Voici pour cela quelques pistes. L'important est de démontrer que l'on est un ingénieur mature et méthodique et non un bricoleur virtuose et ingénieux.
- Le mémoire doit exposer ce que l'on a conçu et construit.
- Il doit représenter ce que l'on maîtrise le mieux grâce à un vécu solide (fuir les sujets que l'on ne connaît qu'en théorie).
- Tout ce qui y est écrit doit être maîtrisé pour pouvoir répondre sereinement aux questions du jury.
- Il doit témoigner d'un travail personnel au travers duquel on a apporté une contribution importante.
Préférer un sujet sur lequel on a travaillé récemment ou que l'on travaille encore. J'ai préféré présenter mon plus beau projet dans le sens où il a fait appel à la plus grande palette de compétences. Cela m'a coûté cher en temps car, pour me replonger dans mon « beau projet », j'ai notamment remonté une plate-forme complète à mon domicile (routeur, serveurs, postes, ...).
Le but de l'examen est de diplômer des gens qui sont déjà ingénieurs de part leur pratique professionnelle. Si votre projet et votre façon de le mener démontrent que c’est votre cas, alors tous les espoirs sont permis, même si vous présentez, par exemple, le déploiement à grande échelle d'un logiciel intranet avec toute la gestion de projet associée, mais sans l’analyse et le développement. De toute façon, ne vous affolez pas car vous ne vous lancerez dans la rédaction du mémoire qu’une fois son sujet et son plan validés par votre jury.
Bien souvent, de part la richesse de votre expérience, vous devez choisir votre sujet de mémoire parmi de nombreux projets éligibles. Ainsi, un candidat m’a un jour fait part de son hésitation face aux sujets suivants :
- Son projet le plus complet (contexte, dimension du projet, responsabilités, innovation technique, …) réalisé plusieurs années auparavant. C’était un projet très intéressant à plus d’un titre (international, notoriété, collaboration avec des ingénieurs et docteurs de nombreuses sociétés, ...), mais en rupture avec les missions qui lui étaient habituellement confiées (réalisation d'un produit de bout en bout avec une équipe constituée en interne).
- Un projet assez récent et représentatif de son activité d'ingénieur, mais qui n'a duré que quelques mois.
- Un projet très récent de recherche interne qu’il a initié et qui s’avère différent des autres de part son secteur d'activité et le fait qu’il ne réponde pas à la demande d'un client externe.
Je lui ai recommandé d’opter pour le plus ancien qui présente l’avantage d’être le plus large, afin de montrer au jury la variété de ses compétences. Je lui ai par ailleurs suggéré de le préparer avec un sujet de secours et de demander l'avis du jury lors de son entretien d'évaluation, pour prendre la décision finale. Ce candidat a été reçu.
Tous les projets des mémoires d'ingénieur DPE parlent d'une entreprise où ils ont été menés. Si vous êtes sans emploi, vous pouvez tout de même déposer votre candidature, dès lors qu'elle répond aux critères d'éligibilité (au moins 5 ans d'activité professionnelle caractéristique d'un d'ingénieur). Pour trouver votre sujet de mémoire, puisez donc parmi les projets que vous avez menés lorsque vous étiez en poste.
Il est préférable de ne pas rédiger un état de l'art sur son sujet de mémoire. En effet, les examinateurs savent bien qu'il y a le manuel du parfait petit ingénieur et, à côté, la vraie vie. On s'attend donc à ce que vous plantiez le cadre méthodologique et que vous montriez comment vous composez avec en intégrant les contraintes du projet (coûts, qualité attendue, délais, culture d'entreprise, organisation, etc.).
Si l’épreuve d’évaluation est passée avec succès, il est demandé au candidat de proposer un sujet et un plan de mémoire. Il ne s’agit pas de produire un roman fleuve mais de planter le décor. Ainsi, voici ce que cela aurait donné si je m’y étais pris correctement (j'ai dû refaire mon mémoire).
Sujet : refonte de l’informatique des agences d’une compagnie d’assurances dans le cadre du passage à l’an 2000.
Plan :
- Sommaire
- Introduction
- Etat des lieux et synthèse des besoins
- Objectifs et méthode employée pour les atteindre
- Mise en œuvre transitoire répondant aux besoins prioritaires
- Généralisation des configurations modulaires avec financement et service
- Capitalisation sur la nouvelle infrastructure pour compléter l’offre
- Conclusion
- Bibliographie
- Annexe 1 : détails sur l’organisation du projet
- Annexe 2 : sélection des composants logiciels et matériels
- Annexe 3 : conventions harmonisées entre siège et agences
- Annexe 4 : détails techniques
- Annexe 5 : mises à jour et précautions pour le passage à l’an 2000
- Annexe 6 : glossaires
Le regard extérieur d'une personne pertinente peut être d'une grande aide. L'idéal est d'avoir un tuteur expérimenté capable d'apporter des conseils éclairés. Pour ma part, je n'en n'ai pas eu. J'ai compensé ce manque en consultant à diverses reprises des collègues ingénieurs diplômés dont j'avais eu l'occasion de constater la compétence.
A défaut ou en complément de vos relations, vous pouvez également obtenir de l'aide auprès de la Société des Ingénieurs Diplômés Par l’État (SIDPE) ou dans le groupe LinkedIn des « Candidats DPE ».
Ce document décrit la migration en environnement 32 bits et TCP/IP d'une informatique basée sur DOS, Windows 3.1, NetWare et IPX/SPX. Toutes les étapes du projet sont décrites : état des lieux, analyse des besoins, étude d'orientations et de faisabilité, conception technique, documentation, sélection et négociation des produits, financement, organisation, plan de communication, formation, déploiement, passage à l'an 2000 et bilan. D'un existant peu communicant, on arrive à un système interconnecté à l'échelle nationale, avec authentification unique, messagerie électronique et accès à Internet. La satisfaction des utilisateurs (des agents d'assurances et leur personnel) et la réduction des coûts sont les axes majeurs du projet.
L'informatique existante au début du projet peut se résumer ainsi :
- 7 types de configuration vaguement standardisées, trop coûteuses et répondant mal aux besoins,
- De nombreuses versions du DOS, de Novell NetWare et de MS Works,
- Windows 3.1 très présent avec un peu de Windows 95,
- 3 langages de développement (dont 2 anciens) pour 6 logiciels métier très restrictifs en matière d'imprimantes,
- Matériels hétéroclites et souvent anciens dont les agents d'assurances sont propriétaires,
- Outils et méthodes de support artisanaux,
- Quasi absence de documentation,
- Informatique difficilement maîtrisable, peu fiable et faiblement sécurisée,
- Relations tendues avec les agents d'assurances.
A l'issue du projet, l'informatique des agences est profondément modifiée :
- Configurations modernes, modulaires, standardisées, administrées à distance, sécurisées, peu coûteuses, répondant à l'essentiel des besoins,
- Composants logiciels et matériels rationalisés et homogénéisés,
- Réseau IP englobant toutes les agences,
- Outils et méthodes industrialisées, plan documentaire,
- Financement mensualisé pour les agents d'assurances incluant équipements et services.
Pour l'essentiel, les technologies mises en œuvre ne sont pas d'une folle originalité : Windows NT4 sur plate-forme Intel, TCP/IP, routeurs RNIS, Exchange, RADIUS, télémaintenance, IPSec. En revanche, elles sont implémentées progressivement, après des études méthodiques menées sans parti pris.
Mon mémoire est disponible en téléchargement sur ce site web.
Pour rédiger mon mémoire, je m'y suis pris longtemps à l'avance. D’ailleurs, j'avais déjà un plan au moment de l'entretien d'évaluation. Cela ne m'a pas empêché de rater lamentablement mon document puisque le jury m'a demandé, à l'issue de ma soutenance, de le refaire entièrement. Le plus important n'est donc pas de coller à un calendrier de rédaction mais de vraiment comprendre ce que l'on attend d'un mémoire d'ingénieur, avant d’entamer les travaux d’écriture. N’hésitez donc pas à parcourir mon petit site web qui, je l’espère, vous apportera les éléments nécessaires à cette compréhension.
Lors de mon entretien d'évaluation, le jury m'a donné les conseils retranscrits ci-dessous.
- Exposer les bénéfices retirés du projet en termes de méthodologie, de technique, etc. En réponse à ce conseil j'ai placé, dans la conclusion, un paragraphe nommé "Bénéfices personnels retirés du projet" (voir la page 82 de mon second mémoire).
- L'aspect technique est essentiel dans le mémoire. La soutenance a notamment pour but de vérifier les compétences qui doivent être de haut niveau. Il ne faut pas, cependant, s'en faire une montagne. J'ai commis cette erreur qui m'a conduit à rédiger un premier mémoire illisible car grouillant de détails techniques.
- Montrer que l'on a compris, optimisé, que les choix sont justifiés, en particulier sur le plan technique.
- Montrer que l'on a du recul en exposant, dans la conclusion, ce que l'on changerait aujourd'hui dans le projet.
Lors de l'élaboration du plan de mon premier mémoire, le Professeur Yann POLLET m'a demandé de bien faire apparaître :
- Mon rôle dans le projet,
- Les critères de choix pour les solutions techniques et les évaluations des solutions.
Durant la rédaction de mon second mémoire, le Professeur René CHEVANCE m'a distillé les conseils suivants.
- "Il conviendrait que votre rôle au sein du projet soit décrit dès le début et non en conclusion."
- "Une partie bilan serait nécessaire dans la conclusion, vous pouvez alors reprendre des éléments concernant votre rôle dans le projet."
- Pour éviter "que le corps du mémoire soit volumineux et peu digeste, examinez si certaines parties ne peuvent pas être reportées en annexe."
- "Dans le corps du mémoire, vous devez mettre en évidence votre maîtrise du sujet et votre prise de recul."
- Lui ayant demandé des éclaircissements sur ce dernier point, voici ce qu'il m'a répondu : "Votre prise de recul et votre maîtrise du sujet peuvent s'exprimer en vous éloignant d'un exposé narratif, en dérivant d'un fait une propriété générale, et tirant la leçon d'une expérience, ...".
Il est fréquent de ne pas se faire comprendre parce que le vocabulaire que l’on emploie a une signification différente pour ceux qui nous lisent ou nous écoutent. Pour éviter de fâcheuses incompréhensions avec le jury je vous propose une démarche assez simple. Elle consiste à d'appréhender l'univers des examinateurs afin d’utiliser le même langage qu'eux, quand le projet que l'on présente et la façon que l'on a eu de le traiter s'y prêtent.
Pour vous expliquer cette approche, je vais vous raconter une anecdote. Dans mon projet, j'avais besoin d'évaluer le trafic réseau de mon architecture cible pour définir les caractéristiques techniques des équipements nécessaires. Pour cela, j'ai effectué des campagnes de mesures. Ensuite, à partir de données constructeur, j'ai réalisé des estimations du futur trafic réseau suivant un cycle de 24 heures. Si je n'avais pas parcouru les supports de cours d'un examinateur, je n'aurais pas pensé parler d'une « modélisation » horaire du trafic réseau. Lors de la soutenance, j’ai bien vu que ce mot a parlé au jury.
J'ai donc choisi mon vocabulaire avec soin pour améliorer mes chances. Je pense d'ailleurs que cette démarche est utile pour des autodidactes (les candidats DPE le sont parfois !) car ils n'ont pas acquis tout le vocabulaire académique qui parle aux examinateurs, contrairement à ceux qui ont eu la chance de suivre leurs cours. Evidemment, il arrive que certains candidats ultra-spécialisés aient plus de connaissance que le jury dans un domaine précis. Dans pareil cas, il est préférable de proposer son vocabulaire en l’argumentant. Bref, à vous de voir ce qu’il convient de faire.
Ce préambule passé, voici ma petite méthode. Elle réclame un peu de travail : j'y ai consacré 3 heures par jour durant deux semaines. Il vaut mieux faire cela longtemps avant la soutenance car les CV des examinateurs peuvent s'avérer très impressionnants, au point de faire perdre ses moyens au candidat lors de l'épreuve finale. La démarche est la suivante :
- Dans un moteur de recherche tel que Google, entrer le nom et le prénom d'un membre du jury,
- Enregistrer localement tous les documents intéressants (photos, pages web, documents bureautiques, etc.),
- Lire en diagonale tous les documents trouvés et dresser une fiche synthétisant le profil de l'examinateur (spécialités, réalisations, etc.),
- Parmi les documents survolés, sélectionner quelques documents particulièrement dignes d'intérêts tels que des supports de cours,
- Lire attentivement ces documents, apprendre ce qu'il faut en apprendre (comme disait le père de Pagnol « il ne faut jamais manquer une occasion de s’instruire ») et en extraire une liste de concepts et de vocabulaire utiles pour le mémoire,
- Recommencer l'opération pour chaque membre du jury.
Attention, il faut faire cela avec subtilité : les membres du jury ne doivent pas avoir l'impression de lire leurs ouvrages en étudiant le mémoire. Il ne s'agit pas, non plus, de brosser le jury dans le sens du poil pour se faire apprécier, mais d'acquérir un vocabulaire et des concepts communs avec lui pour mieux se faire entendre.
Il est aisé de s'égarer en raison de l'étendue du projet que l'on présente. C'est, du reste, ce qui m'a valu de refaire mon mémoire ! Ce que j'en ai compris, c'est qu'il ne faut pas aller au détail sur tout (c'est ce que j'ai fait dans mon premier mémoire). Pour éviter cette noyade, utilisez les détails techniques pour souligner la pertinence de votre démarche méthodologique. Les détails intéressants (prouesse technique par exemple) peuvent être vulgarisés dans le corps du mémoire et détaillés en annexe. N'oubliez pas que le mémoire doit être lisible par tout ingénieur (ou universitaire de niveau équivalent) qui n'est pas spécialisé dans votre domaine.
Le contenu du mémoire doit être suffisamment explicite pour être compréhensible par un lecteur ne connaissant pas la spécialité. De plus, sa lecture doit être agréable. Ainsi, j'aurais dû me méfier lorsque mon épouse, diplômée en Lettres, a trouvé mon premier mémoire rébarbatif et difficile à comprendre. Elle a, en revanche, trouvé la seconde version de mon mémoire plus vivante et accessible. Il est donc vivement conseillé de faire lire son mémoire à plusieurs personnes, de préférence spécialistes d'une autre discipline, afin de recueillir leurs avis.
Petit détail : n’oubliez pas que les phrases longues nuisent à la lisibilité. Pour éviter de fatiguer votre jury, ne faites pas comme Proust ! Veillez également à l’orthographe et à la grammaire. On a beau les surnommer « science de l’imbécile », un mémoire bourré de fautes vous fera rapidement glisser dans la catégorie des incultes. Il va sans dire que cela n’aiderait pas le jury à voir en vous un brillant ingénieur.
L'introduction est très importante. Elle doit donner envie de lire la suite de l'ouvrage, être un résumé susceptible de convaincre un manager à approuver le projet. Le discours tenu doit y être direct, clair et percutant. Je vous invite à comparer les introductions de mes deux mémoires : celui qui a été refusé et celui qui m'a valu d'être diplômé.
Le plan, matérialisé par la table des matières, doit être clair. Dès sa consultation, on doit comprendre de quoi il traite, donner une idée du degré d'implication de son rédacteur et mettre en lumière la méthodologie mise en œuvre. Les titres doivent être accrocheurs et compréhensibles par tout un chacun. Par exemple, dans mon premier mémoire, mon rôle dans le projet était décrit, en introduction, dans le paragraphe nommé "Acteurs concernés". Dans le second mémoire, il est mis en exergue, toujours dans l'introduction, dans le paragraphe "Mon rôle dans le projet".
Un état des lieux et un inventaire des besoins ne sont en général pas de nature à passionner le lecteur. Il est cependant difficile d'échapper à leur rédaction. Pour améliorer la lisibilité, dans mon second mémoire, j'ai regroupé ces deux études dans un même chapitre. La situation constatée et le besoin qui en découle sont accolés dans chaque paragraphe. Pour rendre le tout plus lisible et plus attrayant, j'ai choisi d'y placer des repères iconographiques situés dans la marge. Le Professeur René CHEVANCE, a trouvé cette idée tout à fait acceptable. D'autres personnes consultées ont trouvé l'idée originale mais susceptible de déplaire à un jury trop classique. A vous de voir s’il est pertinent de l’utiliser, quitte à consulter un membre de votre jury sur ce point.
Dans mon premier mémoire, je n'ai pas osé écrire « je ». Le résultat était totalement impersonnel au point que l'on n'arrivait pas à distinguer clairement ma valeur ajoutée. Dans mon second mémoire, je n'y suis pas allé de main morte et ce, dès la table des matières et l'introduction. Ce que je prenais initialement pour de la vantardise a finalement payé ! Il faut savoir se vendre alors, sans transformer votre mémoire en autobiographie, parlez y de vous.
Le mémoire doit faire état d'un travail personnel et mettre en évidence une démarche méthodologique solide. Tous les choix doivent être justifiés. Par exemple, j'ai placé des tableaux comparatifs à de nombreux endroits pour synthétiser les avantages et inconvénients de chaque solution. Les schémas et autres plans ne doivent pas être les photocopies de documents d'entreprise avec un logo bien voyant. Pour que le jury n'aille pas imaginer que j'aurais volé le travail d'autrui, j'ai choisi de refaire tous les schémas.
Même si le travail fourni sur le projet est réellement personnel, il se peut que certaines parties aient été réalisées par d'autres personnes. Cela n'a rien de rédhibitoire. Au contraire, les évoquer dans le mémoire permet de montrer sa capacité à travailler en équipe ou à fédérer différents acteurs.
Le travail présenté par le mémoire ne doit pas être scolaire mais démontrer que l'on a du recul face à son métier, ce qui témoigne d'une certaine maturité. Par exemple, j'ai exposé mon cycle de projet en l'argumentant : un mélange bien dosé de cycle en V et de démarche itérative avec plusieurs lots (voir les pages 26 et 27 de mon second mémoire). Dans le même but, j'ai rédigé en conclusion un paragraphe dédié aux améliorations possibles (voir la page 81 de mon second mémoire).
Il ne faut pas perdre de vue que le DPE est un processus de validation des acquis professionnels. Il ne faut donc pas hésiter à démontrer la richesse de son expérience professionnelle.
La bibliographie représente une certaine charge de travail qu'il convient de ne pas négliger. De plus, il ne faut pas y placer des ouvrages " juste pour faire beau ". En effet, tout ce qui est écrit dans le mémoire représente autant de questions potentielles de la part du jury lors de la soutenance.
Dans le mémoire, il est conseillé d'être très complet sur les sujets où l'on est un peu juste. A contrario, on peut se permettre moins de précision sur les aspects que l'on maîtrise parfaitement. Ainsi, durant la soutenance, le jury sera plus enclin à questionner sur les parties que l'on maîtrise, le mémoire s'avérant flou à leur sujet. En revanche, il ne pensera peut-être pas à poser des questions embarrassantes, le mémoire étant suffisamment explicite dans les matières problématiques.